Louise Bonne d'Avranches
La Louise Bonne d’Avranches est une ancienne variété, le marquis Jean de Vivonne à trouvé cette poire prêt de Charroux (département de la Vienne). Il l’a dédiée à sa femme Louise de Torchart, d’où son nom. Durant le moyen Age, elle est cultivée par Jean Baptiste de la Quintinie, dans le potager du roi, à Versailles. Elle plaisait beaucoup au Roi Louis XIV.
De nos jours, elle se présente sous une abondance de synonymes tels que ‘’Louise Bonne Ancienne ‘’, ‘’Louise de Torchart’’, ‘’Saint Germain Blanc’’
QUALITE GUSTATIVE
QUALITE GUSTATIVE
- Fruit : forme arrondie et allongée (environ 7m de diamètre)
- Peau: rouge/jaune dorée, soyeuse quelques rayures rouges
- Chair: pale, juteuse, fine et croquante. Acidulée et bien sucrée.
- Qualité: Son goût se rapproche de celui d’une noix. Parfum agréable et exotique.
RESISTANCE ET SENSIBILITE
- Variété très fertile, vigoureuse, forte productivité, un peu d’alternance.
- Peu sensible au feu bactérien mais sensible à la tavelure, bonne résistante aux manipulations. Elle se comporte très bien en altitude et est adaptée à toutes les régions.
- Autostérile, doit être implanté avec une autre variété comme Beurré Hardy.
FLORAISON ET CUEILLETTE
- Floraison : précoce en mars-avril, mais peu sensible aux gelées printanières, fleurs blanches
- Cueillette : de fin aout à mi-septembre, éviter les zones ventées
- Durée de conservation : 4 mois, peut parfois blettir si elle est trop longtemps conservée
PORTE GREFFE
- BA29 ou cognassier de Provence (vigueur moyenne)
- Mise à fruits à partir des 3-5 ans de l’arbre
- Hauteur maximale (environ 3 m 50)
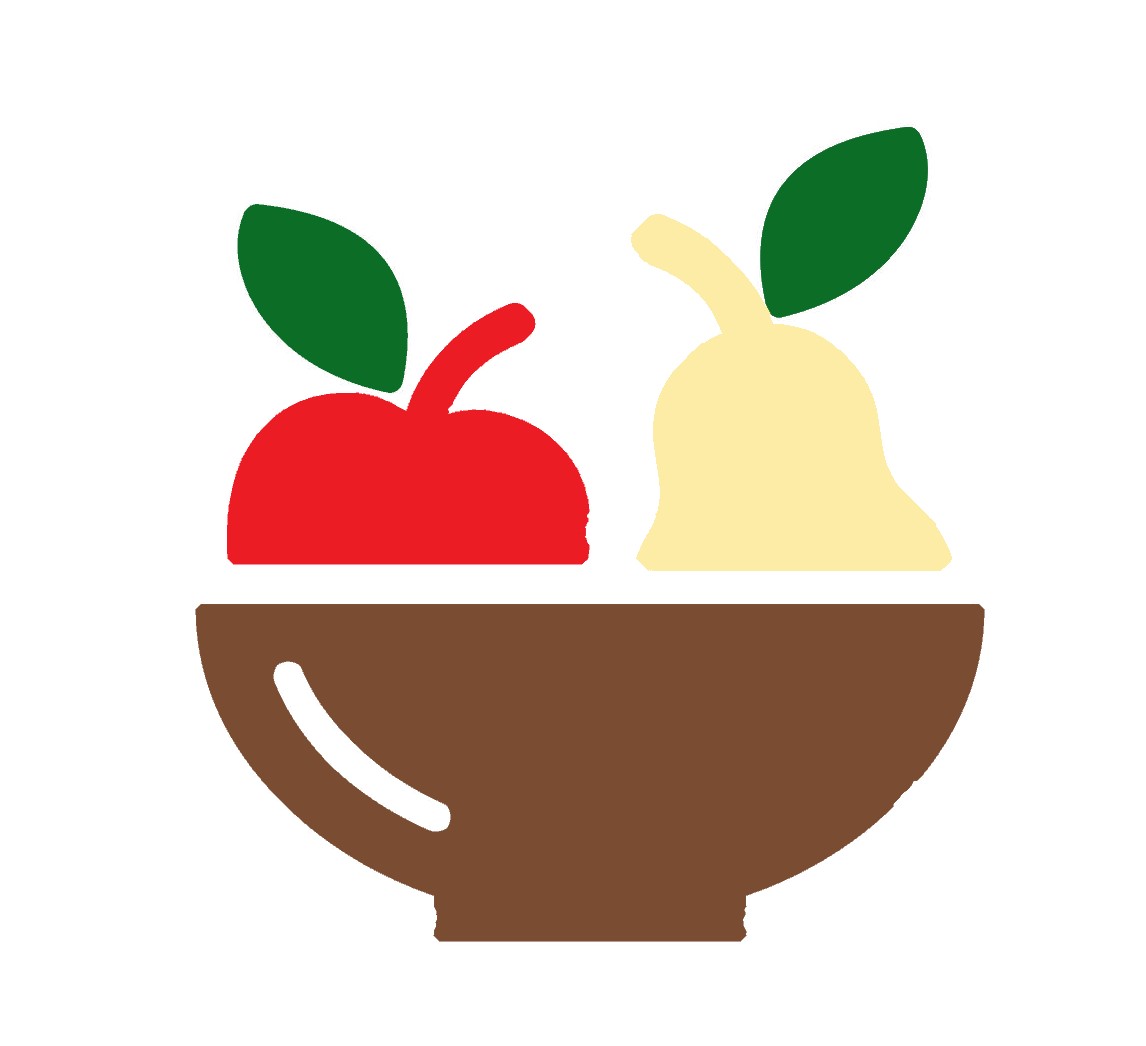

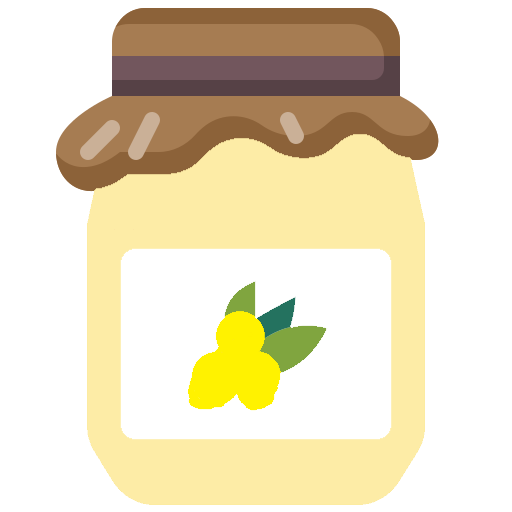
Usages : principalement sous forme de compote, peut être consommées cru, en pâtisseries, en conserves, ou pour faire de l’alcool.
Au début du XXIIe siècle, les habitants exploitent de petites fermes d’élevage (vaches, cochons, volailles, lapins) et pratiquent la polyculture. Ils cultivent des arbres fruitiers essentiels à leur survie, assurant ainsi l’équilibre alimentaire et économique de leurs familles. Ils sélectionnent des espèces adaptées au terroir et à leurs besoins, comme les pommes à couteau, à cidre, à cuire, ou encore les poires destinées à la consommation ou à la distillation. Lorsqu’ils vieillissent, les arbres entament une seconde vie et sont transformés en bois d’œuvre ou de chauffage.
Une partie des fruits alimente le commerce local, notamment dans les villes de Lyon, Chambéry et Grenoble. Grâce à la proximité des marchés, les producteurs vendent une large gamme de fruits, principalement des pommes et des poires.
À partir de 1935-1940, l’amélioration des transports ferroviaires favorise le développement du commerce de la pomme avec l’Afrique du Nord. Les cultivateurs sélectionnent et plantent des variétés résistantes au transport afin d’approvisionner ces nouveaux marchés.
Dans les années 1960, la démocratisation des échanges met fin à ces exportations vers l’Afrique du Nord. Les agriculteurs se tournent vers la production intensive en vergers basse-tige, mais les pommes locales ne trouvent plus de débouchés. Encouragés par la prime à l’arrachage, ils déracinent massivement les pommiers. Les arbres fruitiers isolés, laissés à l’abandon, se couvrent de gui. Avec l’exode rural et la disparition progressive de l’arboriculture familiale, les traditions fruitières s’effacent. Malgré ces changements, certains agriculteurs implantent encore des vergers en culture intensive avec des variétés modernes.
Disparition des anciennes variétés


